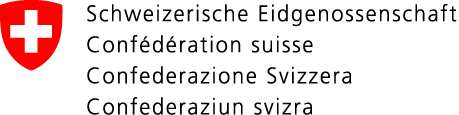novembre
Éditorial
Aujourd’hui, quasiment personne ne peut s’imaginer voyager dans un véhicule non climatisé par une journée d’été caniculaire. Et pourtant : il y a trente ans, c’était la norme dans les trains, lorsque la flotte des CFF se composait majoritairement de voitures dites unifiées I et II. Pour se rafraîchir, il n’y avait alors qu’une seule solution : abaisser les fenêtres et apprécier le vent de la course. En hiver, ce n’était guère mieux : les parois étaient froides au toucher en raison de la mauvaise isolation, les fenêtres n’étaient pas étanches et les chauffages à résistance sous les sièges réchauffaient surtout les pieds.
Clairement, les véhicules de transport public sont devenus plus confortables, grâce à une meilleure isolation et à des systèmes de chauffage, de refroidissement et de ventilation sophistiqués. Le grand défi aujourd’hui est de maintenir le confort des véhicules à tout moment, mais sans pour autant gaspiller de l’énergie. Baisser la température ambiante en hiver serait une mesure simple, mais elle ne doit pas entraîner une perte de confort pour les passagers. Deux projets récents menés par différentes entreprises ferroviaires avec le concours de la Haute école de Lucerne (HSLU) dans le cadre du programme SETP 2050 ont montré que la majorité des passagers ne trouvent pas les véhicules trop froids lorsque la température ambiante est abaissée de 3 degrés. Une baisse générale de cette ampleur permettrait d’économiser jusqu’à 38 GWh d’énergie électrique par an, ce qui correspond à la consommation d’énergie de 9500 maisons individuelles typiques avec quatre personnes. L’Union des transports publics recommande maintenant aux entreprises de transport d’envisager une baisse permanente de la température ambiante.

Les clients des transports publics ont raison d’attendre que les véhicules soient maintenus à une température agréable, été comme hiver. En même temps, il est impératif d’économiser de l’énergie. Comme le montre une étude préalable de la HSLU, différentes mesures permettent de réduire la consommation d’énergie sans réduire le confort thermique.
Les besoins en énergie pour le chauffage, la ventilation et la climatisation (CVC) sont considérables. Ils peuvent représenter 20 à 40 % de la consommation d’énergie totale de l’exploitation. Le potentiel d’économies serait donc intéressant. C’est pourquoi le programme SETP 2050 soutient depuis le début des études dans le domaine CVC, notamment l’étude de synthèse P-192, publiée il y a deux ans. La HSLU y a présenté les mesures connues à ce jour pour économiser l’énergie dans les véhicules des transports publics et a tenté de quantifier leur impact.
Dans l’étude de suivi P-229, la HSLU a élargi cet inventaire en interrogeant des spécialistes et en approfondissant les effets des mesures sur le confort thermique et sur l’efficacité énergétique. Il en ressort que la plupart des mesures d’économie d’énergie n’affectent pas le confort thermique. Il s’agit par exemple du mode snooze, de la régulation de la ventilation au moyen de capteurs de CO2, de l’utilisation de pompes à chaleur ou d’une baisse modérée de la température à l’intérieur. Certaines mesures améliorent même le confort et le bien-être, notamment l’isolation des parois du véhicule et l’emploi de fenêtres hautement isolantes.
L’étude s’est également penchée sur les règles que l’industrie et les exploitants doivent respecter en matière de confort thermique et d’efficacité énergétique des systèmes CVC. Elle conclut que les normes et directives en vigueur imposent aux différents moyens de transport des exigences différenciées qui, selon les spécialistes interrogés, sont généralement respectées sans problème. Toutefois, elles ne contiennent guère de prescriptions relatives à l’efficacité énergétique. Les auteurs estiment qu’il est nécessaire et important de rattraper le retard afin de mieux exploiter le potentiel d’économie d’énergie des installations CVC, notamment pour les véhicules à batterie qui gagnent en autonomie lorsque leur besoin en énergie dédiée aux CVC est faible.
À propos : vous trouverez plus d’informations sur le terme « confort thermique » dans la newsletter de novembre 2023.
D’après une étude réalisée l’hiver dernier, une baisse de la température ambiante de 1 à 3 degrés permet de réduire de jusqu’à 2 % la consommation d’énergie des trains et des trolleybus, soit de 38 GWh par an. L’enquête menée auprès des passagers dans le cadre d’une autre étude réalisée par différentes entreprises de transport et la HSLU montre que la satisfaction n’a pas changé pour autant : elle reste très grande. Sur cette base, l’Union des transports publics recommande aux entreprises d’envisager une baisse durable de la température ambiante.
L’hiver dernier, en raison de la pénurie d’électricité, les entreprises de transports publics ont décidé de réduire temporairement les températures à l’intérieur des véhicules. Sous la direction des CFF et avec le soutien de la HSLU, BVB, RBS, SOB, tl, thurbo et zb ont participé à une enquête menée auprès de leurs passagers. L’objectif était de savoir si les passagers trouvaient la température trop froide, trop chaude ou agréable. Au total, environ 29 400 passagers ont été interrogés au cours de 107 journées d’enquête entre fin janvier 2023 et début mars 2023. Environ 13 200 réponses ont été obtenues dans le transport grandes lignes (TGL), 14 800 dans le transport régional (TRV) et un peu plus de 1400 dans le transport local (TL). Pendant l’enquête, la température effective de l’air ambiant a été enregistrée dans les véhicules à l’aide de capteurs de données. La Confédération a participé au financement par le biais du programme SETP 2050.
Les résultats montrent une corrélation entre la durée du trajet et la température jugée agréable : pour les trajets plus longs (TGL), elle se situe entre 20 et 22°C, pour les trajets de moins de 20 minutes (TRV), elle se situe entre 18 et 20°C. Lorsque la durée du séjour des passagers est inférieure à 10 minutes (TL), la satisfaction reste élevée, même à 16°C ou à 17°C. Les auteurs en concluent que des températures-cibles respectivement de 21°C, 19°C et 16°C sont possibles dans le TGL, le TRV et le TL, sans que la satisfaction des passagers en soit affectée. Cela correspond à une baisse de 1 à 3°C par rapport aux valeurs-cibles habituelles aujourd’hui.
Aussi simple que cette mesure puisse paraître, sa mise en œuvre n’est pas sans difficultés. Ainsi, un effet durable requiert la modification de la courbe de chauffe : pour les véhicules récents, celle-ci peut être reprogrammée en atelier, pour les véhicules plus anciens, le constructeur doit modifier, tester et autoriser le logiciel. Les auteurs recommandent également de prendre en compte, outre le temps de parcours, les caractéristiques individuelles des véhicules, car la température de surface des parois et les déplacements d’air, par exemple, influencent la perception de la température. Ils conseillent en outre d’associer les mesures à des sondages afin de pouvoir les réajuster si nécessaire.
Le Comité de l’UTP a pris connaissance du rapport lors de sa réunion du 8 septembre. Il recommande aux entreprises de transport d’examiner dans quelle mesure il est possible d’abaisser durablement la température pour économiser de l’énergie en modifiant le logiciel des véhicules.
Dans le cadre du projet P-239, les VBZ ont démontré par des mesures que leurs trams Cobra pouvaient économiser environ 14,4 MWh par véhicule et par an si la température-cible à l’intérieur du véhicule était abaissée de 2°C. Ils ont ainsi pu confirmer que les estimations théoriques de l’économie potentielle qui découle d’une baisse de la température étaient exactes. Ils veulent maintenant vérifier s’il en va de même pour les trams Flexity modernes.
Il semble évident que les anciens chauffages à résistance des Cobras recèlent un potentiel important d’économies d’énergie. Ce qui l’est moins, c’est de savoir si les trams dotés d’une technologie plus moderne ont le même potentiel. Les trams Flexity, plus jeunes d’une bonne quinzaine d’années, disposent déjà d’un chauffage par pompe à chaleur et de capteurs de CO2 en complément des chauffages par résistance, afin de réduire les besoins en énergie.
Dans le projet de suivi P-278, la courbe de chauffe est maintenant abaissée à différents degrés dans les trams Flexity. Pendant toute la période hivernale, les données énergétiques recueillies par l’ordinateur du véhicule seront collectées et analysées afin de déterminer les économies d’énergie réalisées par rapport aux trams non modifiés. L’essai est accompagné de sondages au cours desquels les voyageurs sont invités à indiquer leur perception de la température. En se basant sur les résultats de l’étude P-273 (voir l’article « Moins de chauffage en hiver : ce qu’en pensent les passagers ») et sur les expériences faites avec les trams Cobra, les VBZ partent du principe que le confort des voyageurs n’est pas affecté par la baisse modérée de la température.
Forum sur l’énergie
Le 30 novembre, la branche se réunira pour le 10e Forum déjà de l’énergie durable, à l’ancien hôpital de Soleure. Le matin, les meilleures pratiques dans le monde des transports publics seront présentées et l’après-midi, des ateliers d’approfondissement seront organisés sur les thèmes du photovoltaïque, des chantiers à faibles émissions, du confort thermique et des batteries lithium-ion.
Nouveau responsable du programme SETP 2050
Nous avons le plaisir de vous présenter le nouveau responsable du programme SETP 2050 : Stany Rochat. Il est actuellement chef du bureau d’Enotrac à Lausanne. Grâce à sa formation d’ingénieur électricien et à ses connaissances dans le domaine du transport ferroviaire, il possède les meilleurs atouts pour diriger le programme SETP 2050. M. Rochat prendra ses nouvelles fonctions à l’OFT le 3 janvier 2024.
juillet
Éditorial
Au cours de ses dix années d’existence, le programme SETP 2050 a étudié de nombreuses solutions techniques pour réduire la consommation d’énergie dans les transports publics. Mais il reste encore de nouvelles questions à résoudre. L’importance de la condensation dans les parois des trains en est un exemple. La Haute école de Lucerne (HSLU) vient de réussir à clarifier, à l’aide de simulations, l’influence des ponts thermiques dans ce sujet complexe . Pour pouvoir se déplacer sans gaspiller d’énergie ni détériorer le climat, il ne faut pas seulement des solutions techniques dans les transports publics, mais aussi une optimisation de tout le système. Dans ce domaine également, les résultats de la recherche en matière de regroupement des offres de mobilité dans un « pack sérénité » personnalisé et de conception d’une mobilité respectueuse du climat dans l’espace alpin s’avèrent instructifs. Dans une approche globale, cette newsletter contient en outre une contribution du programme « Recherche sur l’infrastructure ferroviaire », qui met en lumière des approches d’économie circulaire pour les déblais de voie.
 postauto ag.jpg)
Sans passage de la voiture à moteur fossile aux transports publics, à la voiture électrique, au vélo et à la marche à pied, pas de réduction de la consommation d’énergie ni de l’impact climatique des transports. Mais la barre est placée haut, comme le montre le projet « Sorglos mobil » qui vient de s’achever, car il n’est pas facile de changer les habitudes en matière de mobilité.
Si l’on parvenait à simplifier l’accès aux offres de mobilité et à les regrouper sur une plate-forme, il devrait être possible de convaincre les clients d’opter pour une mobilité plus écologique. C’est avec cette idée en tête que CarPostal a développé, en collaboration avec Zug Estates, Mobility et l’Académie de la mobilité, le produit « Sorglos mobil » dans le cadre du projet SETP P-165 : une solution « Mobility-as-a Service » (MaaS) innovante et globale pour les zones résidentielles. Le lotissement écologique modèle « Suurstoffi » à Risch ZG a servi de laboratoire réel pour tester l’offre à petite échelle.
Dans le cadre du projet qui a duré deux ans, les quelque 500 ménages du lotissement ont pu acquérir un forfait mobilité leur donnant accès à deux voitures électriques et à six vélos de location (vélos électriques et vélos-cargos) devant leur porte, à des tarifs réduits dans les transports publics et chez Publibike ainsi qu’à la flotte de Mobility. Dans la première phase du projet, le forfait a été proposé à un prix fixe, dans la deuxième sous forme de modèle « paiement à l’usage ». 16 personnes ont utilisé l’offre et ont parcouru au total 6’701 kilomètres avec différents moyens de transport. Elles ont ainsi consommé 3,5 fois moins d’énergie et généré 7 fois moins d’émissions de CO2 que la moyenne des habitants du quartier. L’impact environnemental positif a donc été clairement confirmé.
Le succès de l’offre a toutefois été inférieur aux attentes. Cela s’explique en partie par la pandémie, pendant laquelle les transports publics et la mobilité partagée ont eu du mal à se développer. Mais il faut chercher une autre raison, tout aussi importante, dans les habitudes comportementales en matière de mobilité. 84 % des habitants possèdent leur propre voiture. Près de la moitié des personnes interrogées ne voient pas de raison ou de possibilité de réduire leur utilisation de la voiture. Par conséquent, elles ont également jugé que l’offre de Sorglos Mobil ne répondait pas à leurs besoins. L’intérêt pour la mobilité partagée devant chez soi (voitures électriques, vélos électriques et vélos-cargos) a néanmoins pu être éveillé chez les propriétaires de voiture du lotissement Suurstoffi. Mais les riverains ont surtout utilisé ces offres de manière individuelle et se sont montrés réticents à souscrire des abonnements.
Dans l’ensemble, le projet montre qu’un regroupement des offres de mobilité est bien accueilli par les groupes-cibles qui ne se déplacent pas exclusivement ou majoritairement en voiture. Un accès facile et l’accent mis sur les loisirs abaissent le seuil d’inhibition pour essayer l’offre. Il serait également important de mettre à disposition une offre complète et simple via une application mobile, qui combinerait recherche, réservation et paiement. La direction du projet conclut que cela ne sera possible que lorsqu’il existera des normes d’échange de données garantissant la sécurité des données et facilitant la collaboration entre les acteurs de la mobilité.
Les régions de montagne sont particulièrement touchées par le changement climatique, mais elles ont aussi leur propre énergie issue de sources renouvelables, qui représente un grand potentiel pour organiser leur mobilité en ménageant le climat. En prenant l’exemple de la région valaisanne de l’Adret, une étude montre comment ce changement peut être une réussite.
La région de l’Adret s’étend de Saint-Léonard dans la vallée du Rhône jusqu’au Wildhorn (3248 m) en passant par de nombreux villages et hameaux sur des terrasses ensoleillées et par le domaine skiable d’Anzère. Il est évident que les défis techniques en matière de transport ne sont pas les même ici que dans une agglomération du Plateau. L’approche proposée par le Centre de développement durable des Alpes, qui y est implanté, en collaboration avec la Haute école spécialisée de Suisse occidentale (HES-SO) Valais-Wallis et la société Transportplan est cependant tout à fait transposable.
Le point de départ est le bilan climatique actuel de la région, qui montre que dans le domaine de la mobilité, 95 % des émissions de CO2 et de la consommation d’énergie sont causés par les véhicules privés. L’étude met donc l’accent sur les ménages afin de parvenir à une mobilité respectueuse du climat et efficiente sur le plan énergétique. Pour ce faire, une démarche en trois étapes est esquissée.
L’objectif à court terme est de sensibiliser la population. Pour y contribuer, le projet a développé une brochure, un site Web et un outil d’aide à la décision en ligne. À moyen terme (d’ici à 2030), l’objectif est de réduire le taux de motorisation d’une partie des ménages en les incitant à renoncer à leur deuxième voiture et en favorisant les alternatives à la voiture individuelle (autopartage, bus à la demande, développement de la mobilité douce, coworking etc.). Enfin, d’ici à 2040, les transports ne devraient plus du tout générer d’émissions. Pour cela, les ménages devraient passer entièrement aux véhicules électriques et produire au moins partiellement l’électricité nécessaire à cet effet grâce leurs propres installations photovoltaïques. Les transports publics devront être électriques ou hybrides. Pour couvrir les besoins supplémentaires en électricité pour la mobilité, davantage d’énergie renouvelable doit être produite sur place, par exemple avec une installation solaire flottante sur le lac artificiel de Tzeusier.
Comme pour les bâtiments, les ponts thermiques sont un inconvénient important dans les véhicules : ils réduisent l’efficacité de l’isolation et peuvent diminuer le confort de l’habitacle. De plus, l’humidité peut se déposer sur les ponts thermiques, ce qui peut entraîner la formation de moisissures et la corrosion des parois du véhicule. Les simulations démontrent cependant qu’il ne faut pas s’attendre à une diminution importante du confort thermique.
Les parois des véhicules sont isolées afin de minimiser les pertes d’énergie et d’éviter les surfaces froides dans l’habitacle. Si de l’humidité s’accumule dans ou sur le matériau isolant, l’effet isolant est réduit. L’étude « Calcul de la condensation dans les parois de train » (P-122) publiée en 2019 a montré, au moyen de simulations, que dans les isolations de surface, la teneur en humidité peut certes augmenter en cas différences de température importantes entre l’intérieur et l’extérieur, mais pas au point de provoquer une accumulation d’eau. L’efficacité de l’isolation n’est donc pas affectée.
L’étude ne dit toutefois pas si le risque peut aussi être levée pour les ponts thermiques. Un exemple typique de ponts thermiques dans les véhicules ferroviaires est la suspension en cantilever des sièges, qui est fixée à la paroi du véhicule. Comme l’isolation est interrompue à cet endroit, il existe un risque accru de condensation. Plus celle-ci est abondante, plus des gouttes d’eau se forment localement, ce qui peut entraîner la formation de moisissures et la corrosion de la paroi du véhicule.
L’équipe de la HSLU, Division Technique et architecture, a éclairci la question avec son étude de suivi financée par l’OFT « Kondensation im Zusammenhang mit Wärmebrücken in Zugwänden » (Condensation liée aux ponts thermiques dans les parois des trains). Ses simulations montrent que la condensation est effectivement plus élevée dans les coins et les bords des ponts thermiques. Si des fixations sont vissées sur le mur extérieur sans plaque isolante supplémentaire (donc sans sur-isolation), et si elles sont en outre exposées à un courant d’air convectif, des gouttes d’eau peuvent se former en quelques heures et s’écouler sous l’effet de la gravité. De même, en cas de contact entre le pont thermique et le matériau isolant, la teneur en humidité de l’isolation peut augmenter fortement, de sorte que l’on peut s’attendre à ce que de l’eau s’écoule.
Le confort dans l’habitacle et le bilan énergétique du véhicule ne sont pas affectés par les ponts thermiques, leur proportion surfacique étant en général trop faible pour cela. Pour éviter la corrosion, les auteurs recommandent néanmoins de sur-isoler les ponts thermiques ou, lorsque cela n’est pas possible, d’empêcher l’arrivée d’un flux d’air convectif et d’éviter les accumulations importantes d’eau de condensation dans le matériau isolant en créant un entrefer.
On estime que 0,5 à 0,7 million de tonnes de déblais de voies sont produits en Suisse chaque année. Ce matériau est en fait trop précieux pour être mis en décharge. Il devrait plutôt être traité dans le cadre d’une économie circulaire et réutilisé dans la construction de voies ferrées afin de préserver les ressources naturelles de ballast en roche dure. Comment y parvenir ?
La manipulation correcte des déblais de voie est définie dans la directive du même nom. Toutefois, l’expérience pratique montre qu’une révision s’impose. D’une part, le terme « déblais de voie » n’est pas clairement défini dans la législation sur les déchets. Il existe donc une marge d’interprétation pour la classification des matériaux et les filières d’élimination qui en résultent. D’autre part, la valorisation des matériaux n’est pas encore réglementée de manière contraignante. Certes, une quantité considérable est utilisée dans le secteur de la construction sous forme de mélanges de gravier et de sable. Mais au lieu de ce downcycling , il faudrait viser une réutilisation sous forme de ballast, afin de préserver les stocks de ballast dur qui diminuent dans les carrières nationales.
Les travaux de révision requièrent une base solide. C’est pourquoi l’OFT a commandé, par le biais du programme de recherche sur les infrastructures ferroviaires, l’étude «Verwertungspflicht des Gleisaushubs: Behandlungsverfahren und Verwertungspotenzial» incl. «Teil B: Ökobilanz, Kosten und Öko-Effizienz» (Obligation de valoriser les déblais de voie : processus de traitement et potentiel de valorisation). Cela devrait permettre de définir précisément la notion de « déblais de voie » du point de vue du droit des déchets, puis de l’ancrer dans l’ordonnance du 4 décembre 2015 sur les déchets (OLED). L’étude doit également mettre en évidence les futures voies de valorisation qui correspondent à l’idée d’économie circulaire. L’OFT prévoit de publier une notice explicative à ce sujet à l’automne.
Indicateurs énergétiques des transports publics
Quelle est la quantité d’énergie consommée par les TP ? Quelles sont les parts des différentes sources d’énergie ? Et quel est le bilan climatique des différents moyens de transport ? Les chiffres clés de l’énergie, relevés pour la première fois en 2020, fournissent des informations.
Rapport d’activités
Les rapports sur le programme SETP 2050 sont désormais publiés dans le cadre de la publication « Recherche et innovation dans les transports publics ». Cette publication au format magazine attrayant présente une sélection des projets soutenus l’année dernière dans le cadre du programme SETP 2050, du programme « Recherche sur l’infrastructure ferroviaire » et du programme « Innovation dans le transport régional de voyageurs ». Vous trouverez l’édition actuelle ici. Les éditions des années de référence 2013 à 2021 sont toujours consultables dans les archives.
février
Éditorial
L’hydrogène a beaucoup fait parler de lui l’année dernière. Mais qu’apporte-il vraiment aux transports publics ? Dans quelle mesure peut-il remplacer le diesel et autres carburants dans les bus à pile à combustible, les moteurs à combustion hydrogène et les groupes électrogènes ? Notre newsletter qui rassemble tous les projets d’hydrogène soutenus par le programme SETP 2050 conclut que l’utilisation de l’hydrogène comme substitut aux systèmes à énergie fossile n’est judicieuse, en termes d’efficience et de coûts, que lorsque des batteries ne peuvent pas fournir la quantité d’énergie requise.
 BAV.jpg)
Environ 6000 bus diesel circulent actuellement sur le réseau des transports publics suisses. En raison des objectifs climatiques et énergétiques fixés, il convient de remplacer ces bus par des alternatives neutres en CO2, c’est-à-dire concrètement par des bus à batterie ou à hydrogène. Une étude initiée et commandée par l’OFT, qui examine de près les deux solutions, conclut que le recours à des bus à hydrogène n’est pertinent que sur les lignes interurbaines.
L’étude commandée par l’OFT (P-199) crée la surprise en démontrant que les bus à batteries seront moins coûteux sur l’ensemble de leur cycle de vie que les bus diesel, dès que ces derniers ne bénéficieront plus du remboursement de l’impôt sur les huiles minérales utilisées comme carburant. Cela s’explique notamment par le fait que les bus à batterie requièrent moins d’entretien et consomment beaucoup moins d’énergie. Conformément à ce que prévoit la loi révisée sur le CO2, pour laquelle le Conseil fédéral a adopté le message au Parlement à l’automne 2022, le remboursement de l’impôt précité sera probablement caduc à partir de 2026.
La situation est différente pour les bus à hydrogène (bus à pile à combustible et bus équipés d’un moteur à combustion hydrogène). Les premiers ne sont pas encore rentables, mais pourraient le devenir si, dans quelques années, les prix d’achat baissaient sensiblement en raison d’une augmentation de la production. Les seconds ne sont pas encore disponibles sur le marché, mais pourraient être fabriqués à moyen terme à un prix relativement bas et dépasser les bus à pile à combustible en termes de rentabilité (voir à ce sujet l’article « Le moteur à combustion hydrogène au banc d’essai » dans la présente newsletter).
Même si l’on ignore encore quand l’exploitation des bus à hydrogène pourra être rentable, ils devraient jouer un rôle important pour atteindre les objectifs climatiques dans le transport régional, où les distances à parcourir sont plus longues et, en Suisse notamment, la topographie plus exigeante. En revanche, il n’est pas judicieux d’utiliser des bus à hydrogène dans le transport urbain, où les bus à batterie, nettement plus efficients, répondent aux exigences.
Remplacer les 6000 bus diesel qui circulent sur le réseau des transports publics par des bus à batterie et à hydrogène tout en leur fournissant une électricité neutre en CO2 n’est pas une mince affaire, mais cela reste possible. Des installations photovoltaïques installées sur les surfaces des entreprises de transport peuvent jouer un rôle à cet égard (concernant les possibilités d’encouragement, cf. informations à la fin de cette newsletter).
La polyvalence de l’hydrogène vert en fait le candidat idéal pour la décarbonation de tous les systèmes de transport à forte consommation d’énergie. Son point faible se situe au niveau de sa production : vu que la réaction de l’électrolyse de l’eau nécessite des conditions stables, l’énergie solaire et l’énergie éolienne ne sont que très partiellement adaptées à la production d’hydrogène. Pour compenser les fluctuations d’ensoleillement, les producteurs d’hydrogène vert combinent le photovoltaïque avec l’énergie hydraulique et notamment avec des centrales à accumulation.
Quelle alternative au diesel pour les bus du transport régional ? Les Transports publics fribourgeois (TPF) et la Haute école d’ingénierie et d’architecture de Fribourg (HEIA-FR) examinent des solutions pour des champs d’application à peine couverts par des bus électriques et mettent, ce faisant, l’accent sur les moteurs à combustion hydrogène.
Bien que l’entreprise de transport TPF exploite les lignes de bus dans les villes de Fribourg et de Bulle, la majorité de ses bus circulent en transport régional. Beaucoup de ces bus sont articulés et circulent toute la journée en desservant des lignes à la topographie souvent difficile et parcourant ainsi entre 300 et 350 kilomètres par jour. Il n’existe pas encore de bus électriques capables de couvrir de telles distances sans recharge intermédiaire, particulièrement coûteuse en zone rurale.
Pour ces zones, les solutions à base d’hydrogène peuvent constituer une alternative intéressante, malgré leur rendement énergétique moindre par rapport aux bus électriques. Les bus à pile à combustible sont déjà disponibles sur le marché depuis quelques années. Les bus équipés d’un moteur à combustion hydrogène sont pour le moment moins développés. Dans deux études cofinancées par l’OFT (P-155 et P-255), les TPF, avec le soutien de l’HEIA-FR et de Fiat Powertrain Technologies, examinent la faisabilité technique et économique de l’utilisation de tels bus. L’étude P-155, déjà terminée, conclut qu’il est en principe techniquement faisable d’équiper des bus d’un moteur à combustion hydrogène et que leur prix est également compétitif sur les zones extra-urbaines.
Compétitif à double titre : premièrement par rapport aux bus électriques dont l’exploitation en transport régional est plus complexe et chère, puis deuxièmement par rapport aux bus à pile à combustible. Un bus équipé d’un moteur à combustion hydrogène s’avère plus efficient à plus grande vitesse ou dans des pentes importantes que ses « demi-frères techniques ».
Le moteur à combustion hydrogène a également ses défauts : la combustion d’hydrogène, à l’instar de la combustion de carburants fossiles, génère des oxydes d’azote : C’est pourquoi le projet P-255 s’intéresse notamment à trouver un moyen de réduire quasi complètement les émissions d’oxydes d’azote.
Les TPF examinent actuellement les quatre alternatives au diesel : les bus à batterie et les trolleybus pour l’utilisation en zone urbaine, les bus à pile à combustible et les bus à moteur à combustion hydrogène pour le transport régional. Deux ou trois bus à pile à combustible seront probablement mis en service dès 2024 dans le cadre d’un projet-pilote. L’hydrogène vert nécessaire à cet égard sera produit localement dans la centrale hydroélectrique de Schiffenen. Du point de vue de l’efficience, les bus équipés d’une grande batterie et d’une petite pile à combustible s’avèrent d’ailleurs particulièrement intéressants : de tels bus roulent alors principalement avec l’énergie plus efficiente de la batterie, tandis que la pile à combustible ne sert qu’à augmenter l’autonomie quotidienne des quelque 150 km manquants.
Dans une étude financée par l’OFT, les CFF examinent l’utilisation potentielle de l’hydrogène sur les chantiers ferroviaires. L’étude conclut que l’hydrogène constitue en premier lieu une alternative viable pour l’alimentation en courant des chantiers dotés de groupes électrogènes. Il est toutefois moins cher et plus efficient de répondre aux exigences de performance des véhicules des services de construction et des petits engins portatifs par des solutions à batterie.
Les travaux de construction de la voie se déroulent généralement de nuit, lorsque les lignes de contact sont éteintes ou inexistantes et sur des emplacements souvent éloignés du réseau électrique public. Les véhicules, machines, conteneurs de bureau, éclairages de chantier, etc. utilisés doivent donc fonctionner en autonomie énergétique, au moins pour le travail de nuit.
Jusqu’à présent, les chantiers fonctionnaient essentiellement au diesel. D’après la stratégie climatique des CFF, cela doit cependant cesser en 2030 au plus tard. Dans ce contexte, l’entreprise examine où l’hydrogène serait en mesure ou non de remplacer le diesel (projet P-214). Trois secteurs sont étudiés de près : les véhicules des services de construction, les groupes électrogènes et les petits engins portatifs.
Concernant les véhicules des services de construction, il s’avère que des batteries peuvent répondre aux exigences, même si c’est plutôt de justesse : les véhicules (de toute façon) déjà lourds, doivent encore fournir beaucoup d’énergie et cela pendant des heures alors que le poids additionnel des batteries les pousse à leur limite de poids. Le fait qu’ils puissent rapidement recharger leurs batteries via pantographe et ligne de contact lors des allers-retours vers l’établissement constitue un avantage important. Comparé aux batteries, l’hydrogène s’avère nettement moins efficient : dans le cas examiné, il faudrait au moins le double d’énergie ainsi qu’une infrastructure de ravitaillement lourde qui serait difficile à amortir.
La situation est similaire pour les petits engins portatifs. Dans la pratique, les systèmes fonctionnant à batterie suffisent. C’est pourquoi il ne s’avère pas nécessaire de passer à l’hydrogène. La situation serait peut-être différente pour les grands trains de renouvellement de rails et de traverses, extrêmement énergivores, et lorsque la ligne de contact est éteinte. Ces véhicules sont cependant exploités par des entreprises tierces et ne font pas objet de cette étude.
Venons-en finalement à l’alimentation en courant des chantiers par des groupes électrogènes et pour lesquels l’hydrogène reste une solution envisageable. C’est pourquoi, cette année, les CFF soumettent un groupe électrogène mobile à hydrogène à un test pratique.
Les aspects de sécurité constituent également un défi sur lequel l’étude se penche. L’hydrogène est léger et donc volatile, mais il est aussi extrêmement inflammable lorsqu’il s’accumule dans des espaces (partiellement) fermés. En l’état actuel des choses, on ne sait pas si et dans quelles conditions l’hydrogène pourra un jour être utilisé dans des tunnels. Les CFF étudient la question en collaboration avec la Société Suisse de l’Industrie du Gaz et des Eaux (SSIGE), le TÜV et la SUVA. Comme la question concerne l’ensemble de la branche gazière, l’objectif est d’établir, dans le meilleur des cas, une réglementation définissant les conditions dans lesquelles l’hydrogène peut être utilisé dans des espaces (partiellement) fermés.
Laura Amaudruz dirige la division Innovation et développement du réseau des Transports publics fribourgeois Trafic (TPF TRAFIC) SA. Elle dirige, du côté des TPF, les projets P155 et P255 mentionnés dans la présente newsletter. Notre rédaction a rencontré l’ingénieure civile lors d’un entretien.
Quel est le rôle des partenaires régionaux dans la stratégie hydrogène de l’entreprise, sans parler de la Haute école d’ingénierie et d’architecture de Fribourg (HEIA-FR) ?
Le canton de Fribourg dispose de deux futurs fournisseurs d’hydrogène vert, Groupe e et Gruyère Énergie SA. Nous sommes par ailleurs en discussion avec des entreprises de transport par poids lourd qui souhaitent acquérir des camions à pile à combustible. Notre canton héberge également un fabricant d’engins de construction qui, comme nous, entreprend des recherches sur le moteur à combustion hydrogène.
L’avantage, c’est que quelle que soit la technologie utilisée, le plein se fait toujours avec de l’hydrogène. Les infrastructures de ravitaillement peuvent donc en principe être exploitées et utilisées en commun, ce qui est économiquement intéressant.
Les bus à batterie possèdent un meilleur rendement énergétique que ceux fonctionnant à l’hydrogène. L’autonomie des batteries augmente d’année en année. Quand les bus à batterie pourront-ils couvrir l’ensemble des besoins ?
C’est en effet une grande inconnue. Rétrospectivement, on constate que l’autonomie des bus articulés qui circulent en terrain accidenté a augmenté d’environ 30 à 50 km depuis ces cinq dernières années. À l’heure actuelle, l’autonomie atteint environ 200 km sans recharge intermédiaire. Or il nous faut au moins 300 à 350 km d’autonomie.
Est-ce que l’intérêt de la population fribourgeoise ou des voyageurs des TPF pour la décarbonisation des transports ou pour l’hydrogène en particulier augmente ?
Nous constatons un intérêt particulier de la part des riverains des lignes de bus. Les bus électriques étant plus silencieux, les nuisances sonores ont été sensiblement réduites sur le lieu de vie de ces personnes.
D’une manière générale, nous avons l’impression que les passagers s’intéressent à la décarbonisation en général mais que les solutions techniques utilisées pour y parvenir leur sont égales. Les personnes qui s’intéressent explicitement à l’hydrogène sont plutôt des professionnels ayant des activités liées à l’hydrogène.
Dans le domaine des transport publics, il existe de nombreuses surfaces qui seraient idéales pour produire de l’énergie solaire mais qui, pour la plupart, restent en friche jusqu’à présent : des toits et/ou des façades de bâtiments de bureaux, des quais et des bâtiments d’entretien par exemple. C’est ce à quoi on pouvait s’attendre. En revanche, de nombreuses entreprises de transport (ET) n’imaginent pas que des installations photovoltaïques sur de telles surfaces puissent être financées par le biais du fonds d’infrastructure ferroviaire (FIF) et des indemnités pour le transport régional de voyageurs (TRV). Un article du blog OFT Actualités donne un aperçu de tous les instruments d’encouragement proposés aux entreprises de transport.